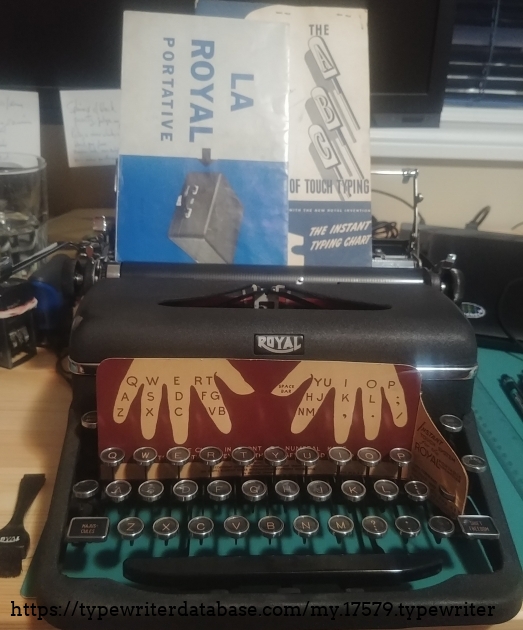Document d'information : Enjeux et Perspectives de la Transition Climatique et Énergétique
Résumé Exécutif
Ce document synthétise les analyses et les perspectives issues de la Journée du Climat organisée à Le Mans Université, dix ans après les Accords de Paris.
Il met en lumière une réalité complexe : si des progrès notables ont été accomplis, les grands objectifs climatiques mondiaux demeurent hors d'atteinte.
Les émissions de CO2 continuent d'augmenter à l'échelle planétaire, et la consommation d'énergies fossiles atteint des niveaux records, principalement en raison de la croissance des marchés asiatiques.
Dans ce contexte, la France représente un cas singulier, avec un mix électrique déjà largement décarboné grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables.
Cependant, le pays fait face à un paradoxe majeur : alors que la consommation réelle d'électricité est en baisse depuis 2017, la politique énergétique nationale prévoit une augmentation massive de la capacité de production. Cette divergence crée un risque de surproduction, de perturbation du marché et de tensions sur le réseau électrique et le parc nucléaire.
La transition énergétique induit également de nouvelles dépendances stratégiques, notamment vis-à-vis des minéraux critiques pour les batteries, les panneaux solaires et les éoliennes, dont le raffinage est massivement contrôlé par la Chine.
La technologie des batteries, pilier de la décarbonation des transports et du stockage des énergies renouvelables, est au cœur de ces enjeux.
L'Europe peine à établir une chaîne de valeur souveraine, comme en témoigne l'échec de projets d'envergure.
Des innovations de rupture, telles que les batteries sodium-ion développées en France, et l'intégration de diagnostics avancés ("batteries intelligentes") offrent des perspectives prometteuses pour améliorer la durabilité et la performance.
Enfin, l'efficacité de la transition repose sur son ancrage territorial.
Les stratégies doivent intégrer les services écosystémiques (comme le carbone bleu), encourager l'implication citoyenne (via les communautés énergétiques) et repenser la gouvernance.
Les approches descendantes, qu'il s'agisse de réglementations européennes ou des négociations climatiques mondiales (COP), montrent leurs limites en peinant à intégrer les réalités et les aspirations locales, soulignant l'impératif d'une concertation plus juste et inclusive.
--------------------------------------------------------------------------------
1. La Transition Énergétique : Entre Progrès et Réalités Incontournables
La transition énergétique constitue le défi central de la lutte contre le changement climatique.
L'analyse présentée par Marc Fontecave, Professeur au Collège de France, dresse un tableau lucide de la situation, soulignant les écarts entre les ambitions affichées et les dynamiques réelles.
1.1. Un Bilan Mondial Contrasté et des Objectifs Hors d'Atteinte
La première observation est sans appel : les objectifs fixés lors des Accords de Paris ne seront pas atteints.
• Objectifs manqués : L'ambition de limiter le réchauffement à 1,5°C d'ici 2100 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050 est désormais considérée comme "relativement inatteignable".
• Hausse des émissions : Les émissions mondiales de CO2 continuent leur progression.
Le rythme d'augmentation en 2024 est comparable à celui des dix années précédentes. Cette hausse est principalement tirée par les marchés asiatiques en croissance rapide, notamment l'Inde.
• Dépendance fossile record : Loin de diminuer, la consommation mondiale de charbon, de pétrole et de gaz naturel n'a jamais été aussi élevée.
Les projections indiquent une augmentation continue des capacités mondiales de charbon et une demande record pour le pétrole en 2025.
• Un fossé persistant : Un écart se creuse entre les connaissances scientifiques, les déclarations politiques et les actions concrètes.
Bien que l'Europe et la France voient leurs émissions territoriales diminuer, ce chiffre doit être nuancé.
Pour la France, une part importante de cette baisse est attribuée à une désindustrialisation continue.
L'empreinte carbone du pays, qui inclut les émissions liées aux importations, ne baisse pratiquement pas.
1.2. La Singularité du Cas Français
La France se distingue par une situation énergétique particulière qui en fait un cas d'étude à part.
• Forte électrification : Avec 25-27 % d'électricité dans sa consommation énergétique totale, la France est l'un des pays les plus électrifiés au monde.
• Électricité très décarbonée : La production électrique française est à 95 % bas-carbone, ce qui place la dépendance du pays aux énergies fossiles juste en dessous de 60 %, une performance bien meilleure que la moyenne mondiale.
• Facture fossile : Cette dépendance représente néanmoins une facture considérable, s'élevant en moyenne à 60 milliards d'euros par an pour l'importation d'hydrocarbures.
Les trois piliers de la transition énergétique pour la France sont :
1. La diminution de la consommation : Tous les scénarios, y compris la feuille de route gouvernementale, prévoient une baisse drastique de la consommation d'énergie, de 1500 TWh actuellement à moins de 1000 TWh.
2. L'électrification des usages : Pour sortir des fossiles, il est nécessaire d'électrifier massivement les transports (véhicules électriques), le chauffage (pompes à chaleur) et l'industrie (fours électriques, hydrogène vert).
L'électrification directe est privilégiée pour son efficacité énergétique supérieure.
3. Le recours au carbone et à la chaleur non fossiles : Pour les usages non électrifiables, des alternatives comme la biomasse (bois, biocarburants), la géothermie et les biogaz sont nécessaires, bien qu'elles présentent des limites (gisements, compétition avec l'alimentaire, empreinte carbone).
1.3. Le Paradoxe de la Consommation et de la Production Électrique
L'analyse de la production et de la consommation électrique en France révèle une divergence préoccupante.
État des lieux de la production électrique française (Données 2024)
Indicateur
Valeur
Commentaire
Production totale
~540 TWh
La France est le premier pays exportateur d'électricité en Europe.
Part du nucléaire
~360 TWh
Socle du mix, assurant près de 70 % de la production.
Production bas-carbone
95 %
Niveau le plus élevé depuis 1950.
Part des fossiles
3,6 %
Niveau le plus bas depuis 1950.
Intensité carbone
21 g CO2/kWh
Parmi les plus basses du monde (vs. ~360 g CO2/kWh en Allemagne).
La politique nucléaire a connu un changement majeur, passant d'un projet de fermeture de réacteurs à la décision d'en construire 14 nouveaux (6 confirmés, 8 en option).
La capacité des réacteurs français à moduler leur production ("pilotabilité") est un atout stratégique pour équilibrer le réseau.
Le paradoxe identifié est le suivant :
• Une consommation en baisse : Contrairement aux projections, la consommation d'électricité en France diminue depuis 2017 pour atteindre en 2024 son niveau de 2004.
Cette baisse s'explique par l'efficacité énergétique, les prix élevés, la sobriété, la désindustrialisation et une électrification des usages plus lente que prévu.
• Une production planifiée en forte hausse : La feuille de route du gouvernement, basée sur des scénarios de consommation désormais obsolètes (projections RTE 2021/2023), prévoit une augmentation de la production de près de 200 TWh, principalement via l'éolien et le solaire.
• Les risques associés : Cette décorrélation pourrait mener à une surproduction structurelle, perturbant gravement le marché, nécessitant une modulation excessive et techniquement risquée du parc nucléaire, et créant des tensions sur les réseaux électriques.
De nouveaux scénarios de consommation revus à la baisse par RTE sont attendus pour corriger cette trajectoire.
1.4. Nouvelles Dépendances et Impératifs de Recherche
La transition énergétique, si elle réduit la dépendance aux fossiles, en crée de nouvelles.
• Dépendance aux minéraux : La production de batteries, d'éoliennes et de panneaux solaires nécessite une quantité croissante de ressources minérales (graphite, lithium, cobalt, cuivre, etc.).
Le raffinage de ces matériaux est très largement dominé par la Chine, créant une nouvelle dépendance géopolitique.
• Maturité technologique : De nombreuses technologies clés ne sont pas encore matures et nécessitent des efforts de recherche et d'innovation considérables.
Cela inclut la production d'hydrogène vert, le recyclage des matériaux, l'amélioration des rendements photovoltaïques, le développement de mines responsables, la décarbonation de l'industrie lourde (acier), la valorisation de la biomasse, le nucléaire de 4ème génération, la modernisation des réseaux et le stockage d'énergie.
--------------------------------------------------------------------------------
2. Le Stockage Électrochimique : Pilier Technologique de la Décarbonation
Les batteries sont au cœur de la transition, essentielles pour la mobilité électrique et pour stabiliser les réseaux face à l'intermittence des énergies renouvelables.
La conférence de Jean-Marie Tarascon, Professeur au Collège de France, a mis en évidence les avancées, les défis et les innovations de ce secteur stratégique.
2.1. L'Ascension des Batteries et le Défi de la Souveraineté Européenne
Le stockage électrochimique est en passe de devenir la forme dominante de stockage d'énergie, dépassant le stockage hydroélectrique.
• Marchés en plein essor : La demande est tirée par trois secteurs majeurs : le véhicule électrique (50 % des ventes mondiales prévues en 2030), le stockage stationnaire pour les énergies renouvelables, et les drones.
• Les Gigafactories : Pour répondre à cette demande, des usines de très grande capacité se construisent dans le monde.
L'Europe, avec plus de 20 projets dont 6 en France, tente d'acquérir sa souveraineté, visant 19 % de la production mondiale en 2029.
• Le manque de chaîne de valeur : L'Europe reste massivement dépendante, important 98 % des machines d'assemblage et une part similaire des matériaux.
L'échec du projet suédois Northvolt, qui visait une intégration verticale complète sans maîtriser toute la chaîne de valeur, illustre cette fragilité. La proposition de créer un "Airbus des batteries" pour fédérer les compétences se heurte aux réticences des acteurs à collaborer.
2.2. Innovations et Matériaux d'Avenir
La recherche scientifique est la clé pour surmonter les dépendances et améliorer les performances.
• Du NMC au LFP : Dans le lithium-ion, la technologie dominante des véhicules électriques évolue.
Les matériaux NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) à haute densité énergétique cèdent du terrain aux matériaux LFP (Lithium-Fer-Phosphate), qui sont moins chers, plus sûrs et ne contiennent pas de cobalt.
Cependant, la production de LFP est contrôlée à 88 % par la Chine.
• La technologie Sodium-ion : Portée en France par la start-up Tiamat, cette technologie représente une alternative stratégique.
Le sodium est 10 000 fois plus abondant que le lithium.
Bien que moins denses en énergie, les batteries sodium-ion offrent une puissance supérieure, une durée de vie exceptionnelle (jusqu'à 17 000 cycles) et un coût potentiellement plus faible.
Elles sont idéales pour le stockage stationnaire (ex: data centers) et la mobilité légère.
• Vers le tout-solide et les batteries intelligentes :
La recherche s'oriente vers les batteries "tout-solide", qui remplacent l'électrolyte liquide par un solide pour plus de sécurité et de densité énergétique, bien que des défis d'interface persistent.
Une autre innovation majeure est l'intégration de capteurs (fibres optiques) au cœur des batteries pour en suivre l'état de santé en temps réel (température, pression, chimie).
Ce "passeport de santé" permettra d'optimiser leur usage, de faciliter leur seconde vie et de développer des systèmes d'auto-réparation.
2.3. Enjeux de Durabilité : Écocompatibilité et Recyclage
La durabilité des batteries est un enjeu aussi important que leur performance.
• Pression sur les ressources :
Un véhicule électrique utilise six fois plus de minéraux qu'un véhicule thermique.
La demande en lithium, cobalt et nickel pourrait dépasser la production d'ici 2030.
L'exploitation de nouvelles ressources, y compris en Europe (comme le lithium en France), et surtout le développement du recyclage ("mine urbaine") sont impératifs.
• Réglementation européenne : L'UE met en place un cadre strict imposant la déclaration de l'empreinte carbone, des taux de matériaux recyclés obligatoires (dès 2030) et un passeport électronique pour chaque batterie.
• Recherche sur le recyclage : Les méthodes actuelles (pyrométallurgie, hydrométallurgie) sont énergivores.
L'un des objectifs de la recherche est de concevoir des batteries "de type Lego", facilement démontables pour un recyclage ciblé de leurs composants.
--------------------------------------------------------------------------------
3. L'Ancrage Territorial : Clé de Voûte d'une Transition Juste et Efficace
La réussite de la transition climatique ne peut être décrétée d'en haut ; elle doit s'incarner dans les territoires, en tenant compte de leurs spécificités géographiques, sociales et économiques.
3.1. Des Territoires aux Stratégies Plurielles
Les approches locales varient considérablement, reflétant la diversité des enjeux.
• Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) : L'analyse des PCAET dans l'Ouest de la France montre un foisonnement d'initiatives.
Si l'atténuation (mitigation) est un axe commun, les notions d'adaptation et de résilience sont traitées de manière inégale, la résilience étant plus prégnante dans les territoires littoraux directement menacés.
• Rôle des écosystèmes : Les écosystèmes locaux sont des alliés pour la neutralité carbone.
Les zones humides littorales, par exemple, stockent massivement du carbone ("carbone bleu") tout en fournissant d'autres services essentiels comme la protection contre les inondations.
• Controverses du "Rewilding" : Les stratégies de restauration, comme le réensauvagement, peuvent générer des conflits.
Laisser des écosystèmes évoluer librement ou réintroduire de grands animaux se heurte aux paysages culturels et agricoles européens, créant des tensions sur les usages et des chocs de valeurs.
Le succès de telles approches dépend fondamentalement de l'inclusion et de la concertation avec les populations locales.
3.2. L'Énergie Citoyenne et les Nouvelles Mobilités
L'implication des citoyens est un levier puissant pour accélérer la transition.
• Communautés énergétiques citoyennes : Des collectifs de citoyens émergent pour produire et consommer localement de l'énergie renouvelable.
Ces initiatives favorisent l'appropriation locale des enjeux, contribuent à la justice énergétique et permettent de lutter contre la précarité.
L'Ouest de la France est une région particulièrement dynamique, accueillant près d'un quart des projets citoyens nationaux.
• Décarboner les mobilités : Le secteur des transports représente 31 % des émissions de CO2 en France, les trajets domicile-travail en voiture comptant pour une part significative (13 % du total national).
Comprendre les facteurs (individuels, contextuels, normes sociales) qui influencent le choix du mode de transport est essentiel pour concevoir des politiques publiques efficaces favorisant les mobilités douces.
3.3. Gouvernance Globale et Concertation : Les Limites du Modèle Actuel
L'articulation entre les décisions locales, nationales et internationales reste un point de friction majeur.
• Approches descendantes : Des réglementations comme celle de l'UE sur la déforestation importée, bien qu'intentionnées, peuvent être perçues comme unilatérales et impérialistes par les pays producteurs, qui se tournent vers d'autres marchés moins regardants.
De même, dans certains pays comme Haïti, les plans climatiques sont souvent impulsés par des acteurs internationaux et déconnectés des réalités du terrain.
• Le défi des COP : Les négociations climatiques mondiales, comme la COP30 au Brésil, peinent à intégrer de manière authentique la voix des populations locales et des peuples autochtones.
Leurs préoccupations sont souvent diluées dans un langage diplomatique visant le consensus, ce qui conduit à une forme de décision à deux vitesses et pousse les groupes non entendus à s'auto-organiser en marge des processus officiels.
L'enjeu est de traduire les aspirations des territoires en politiques internationales concrètes et justes.